
|
|
Voir sur Amazon
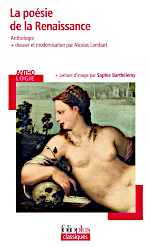
|
 Colère, ardent, furieux, agité,
Colère, ardent, furieux, agité,
Je tremble tout sous la
Divinité.  Pierre de Ronsard.
Pierre de Ronsard.
|
| 1470 |
1547 |
1548 |
1549 |
1553 |
1553 |
1555 |
1558 |
1562 |
 e
mot Pléiade, dans le sens que nous lui connaissons,
a été employé d'abord vers 1563 par les Protestants pour
tourner en dérision l'arrogance des jeunes disciples de
l'humaniste Jean Dorat constitués en Brigade.
Ronsard se plut en effet, en 1553, à élire sept d'entre eux
: leur nombre n'était pas sans évoquer la Pléiade
mythologique des sept filles d'Atlas changées en
constellation, et surtout la Pléiade des sept poètes
alexandrins du IIIème siècle avant Jésus-Christ. A vrai
dire, cette Brigade constitue moins une école qu'un
groupe, d'ailleurs variable, fédéré par la même volonté de rénover
les formes poétiques : e
mot Pléiade, dans le sens que nous lui connaissons,
a été employé d'abord vers 1563 par les Protestants pour
tourner en dérision l'arrogance des jeunes disciples de
l'humaniste Jean Dorat constitués en Brigade.
Ronsard se plut en effet, en 1553, à élire sept d'entre eux
: leur nombre n'était pas sans évoquer la Pléiade
mythologique des sept filles d'Atlas changées en
constellation, et surtout la Pléiade des sept poètes
alexandrins du IIIème siècle avant Jésus-Christ. A vrai
dire, cette Brigade constitue moins une école qu'un
groupe, d'ailleurs variable, fédéré par la même volonté de rénover
les formes poétiques :
— Ronsard, Du Bellay, Jean-Antoine de
(1532-1589), condisciples au collège de Coqueret,
constituent son « noyau dur »;
— venus du collège de Boncourt, s'y agrègent en 1553 Étienne
(1532-1573) et Jean de (1529-1554), remplacé en 1554 par (1528-1577);
— plus lointainement (ils appartiennent à ), s'y associent (1521-1605) et (1529-1581); ce dernier sera
remplacé en 1555 par Jacques (1517-1582).
— enfin, en 1583, cette place est attribuée à pour honorer son magistère.
La Pléiade se caractérise
par un souci de variété dans l'inspiration qui lui fait
privilégier l'exploration de différents genres : à côté d'une
libre imitation des Anciens, les poètes se nourrissent
d'influences modernes qu'ils mettent au service d'une
langue neuve, volontiers érudite, et de mythes
antiques savamment revisités (voyez notre corpus sur l'). Ces jeux poétiques
ne sauraient faire oublier cependant la hauteur de la mission
assignée à la poésie : influencés par le
néoplatonisme, les poètes de la Pléiade y voient l'émanation
d'une « fureur divine » qui place au-dessus du commun cette
figure du poète en mage inspiré dans laquelle
Ronsard se reconnaîtra le premier.
1.
« Par longue et diligente imitation.»
Le souci majeur de la Brigade, élevée sous l'égide de
l'helléniste Jean Dorat, est de faire reculer le «Monstre
Ignorance» par la diffusion de la culture antique.
Conscients de la nécessité d'enrichir la langue française,
ces jeunes poètes voient dans l'imitation des Anciens une
possibilité d'intégrer des formes nobles délaissées par le
Moyen Age et d'enrichir le vocabulaire. Mais ce dogme de
l'imitation touche aussi les modernes, néo-latins ou
italiens, et prend soin de se démarquer d'une simple
servilité. Émile Faguet a appelé "innutrition" cette
assimilation personnelle des sources livresques : « Si,
par la lecture des bons livres, je me suis imprimé quelques
traits en la fantaisie, qui, après [...] me coulent beaucoup
plus facilement en la plume qu'ils ne me reviennent en la
mémoire, doit-on pour cette raison les appeler pièces
rapportées ?» (Du Bellay, Seconde préface de l'Olive,
1550).
Joachim
Du Bellay (1522-1560)
Défense
et illustration de la langue française
(1549)
Rédigé à la hâte pour prendre le contre-pied
de l'Art poétique de Thomas Sébillet,
ce manifeste exprime une "heureuse
inconséquence" (V.L. Saulnier) : préconisant
l'imitation des langues anciennes, il n'exclut
pourtant pas que la langue française rivalise
à son avantage avec elles, et, du même coup,
il alimente une réflexion déjà moderne sur le
caractère transitoire des civilisations.
(orthographe
modernisée)
|
 |
|
Se compose donc celui qui voudra enrichir sa langue à
l'imitation des meilleurs auteurs grecs et
latins : et à toutes leurs plus grandes vertus,
comme à un certain but, dirige la pointe de son
style. Car il n'y a point de doute que la plus
grande part de l'artifice
donc celui qui voudra enrichir sa langue à
l'imitation des meilleurs auteurs grecs et
latins : et à toutes leurs plus grandes vertus,
comme à un certain but, dirige la pointe de son
style. Car il n'y a point de doute que la plus
grande part de l'artifice ne
soit
contenue en l'imitation, et tout ainsi que ce
fut le plus louable aux anciens de bien
inventer, aussi est-ce le plus utile de bien
imiter, même à ceux dont la langue n'est encore
bien copieuse et riche. Mais entende celui qui
voudra imiter, que ce n'est chose facile de bien
suivre les vertus d'un bon auteur, et quasi
comme se transformer en lui, vu que la nature
même aux choses qui paraissent très semblables
n'a su tant faire que par quelque note et
différence elles ne puissent être discernées. Je
dis ceci, parce qu'il y en a beaucoup en toutes
langues qui, sans pénétrer aux plus cachées et
intérieures parties de l'auteur qu'ils se sont
proposé, s'adaptent seulement au premier regard,
et, s'amusant à la beauté des mots, perdent la
force des choses. Et certes, comme ce n'est
point chose vicieuse, mais grandement louable,
emprunter d'une langue étrangère les sentences
et les mots, et les approprier à la sienne,
aussi est-ce chose grandement à reprendre, voire
odieuse à tout lecteur de libérale ne
soit
contenue en l'imitation, et tout ainsi que ce
fut le plus louable aux anciens de bien
inventer, aussi est-ce le plus utile de bien
imiter, même à ceux dont la langue n'est encore
bien copieuse et riche. Mais entende celui qui
voudra imiter, que ce n'est chose facile de bien
suivre les vertus d'un bon auteur, et quasi
comme se transformer en lui, vu que la nature
même aux choses qui paraissent très semblables
n'a su tant faire que par quelque note et
différence elles ne puissent être discernées. Je
dis ceci, parce qu'il y en a beaucoup en toutes
langues qui, sans pénétrer aux plus cachées et
intérieures parties de l'auteur qu'ils se sont
proposé, s'adaptent seulement au premier regard,
et, s'amusant à la beauté des mots, perdent la
force des choses. Et certes, comme ce n'est
point chose vicieuse, mais grandement louable,
emprunter d'une langue étrangère les sentences
et les mots, et les approprier à la sienne,
aussi est-ce chose grandement à reprendre, voire
odieuse à tout lecteur de libérale nature, voir en une même langue une telle
imitation, comme celle d'aucuns savants mêmes,
qui s'estiment être des meilleurs, quand plus
ils ressemblent à un Heroët ou un Marot. Je
t'admoneste donc (ô toi qui désires
l'accroissement de ta langue, et veux exceller
en icelle) de non imiter à pied levé, comme
naguère a dit quelqu'un, les plus fameux auteurs
d'icelle, ainsi que font ordinairement la
plupart de nos poètes français, chose certes
autant vicieuse, comme de nul profit à notre
vulgaire
nature, voir en une même langue une telle
imitation, comme celle d'aucuns savants mêmes,
qui s'estiment être des meilleurs, quand plus
ils ressemblent à un Heroët ou un Marot. Je
t'admoneste donc (ô toi qui désires
l'accroissement de ta langue, et veux exceller
en icelle) de non imiter à pied levé, comme
naguère a dit quelqu'un, les plus fameux auteurs
d'icelle, ainsi que font ordinairement la
plupart de nos poètes français, chose certes
autant vicieuse, comme de nul profit à notre
vulgaire : vu que ce n'est autre chose (ô grande
libéralité !) sinon lui donner ce qui était à
lui. Je voudrais bien que notre langue fût si
riche d'exemples domestiques
: vu que ce n'est autre chose (ô grande
libéralité !) sinon lui donner ce qui était à
lui. Je voudrais bien que notre langue fût si
riche d'exemples domestiques que n'eussions besoin d'avoir recours aux
étrangers. Mais si Virgile et Cicéron se fussent
contentés d'imiter ceux de leur langue,
qu'auront les Latins outre Ennius ou Lucrèce,
outre Crassus ou Antoine ? [...]
que n'eussions besoin d'avoir recours aux
étrangers. Mais si Virgile et Cicéron se fussent
contentés d'imiter ceux de leur langue,
qu'auront les Latins outre Ennius ou Lucrèce,
outre Crassus ou Antoine ? [...]
Quoi donc (dira quelqu'un), veux-tu à
l'exemple de ce Marsyas, qui osa comparer sa
flûte rustique à la douce lyre d'Apollon, égaler
ta langue à la grecque et latine ? Je confesse
que les auteurs d'icelles nous ont surmontés en
savoir et faconde : ès quelles choses leur a été
bien facile de vaincre ceux qui ne répugnaient
point. Mais que par longue et diligente
imitation de ceux qui ont occupé les premiers ce
que nature n'a pourtant dénié aux autres, nous
ne puissions leur succéder aussi bien en cela
que nous avions déjà fait en la plus grande part
de leurs arts mécaniques, et quelquefois en leur
monarchie, je ne le dirai pas; car telle injure
ne s'étendrait pas seulement contre les esprits
des hommes, mais contre Dieu, qui a donné pour
loi inviolable à toute chose créée de ne durer
perpétuellement, mais passer sans fin d'un état
en l'autre, étant la fin et corruption de l'un,
le commencement et génération de l'autre.
I, VIII et
IX
|
 Questions
: Questions
:
- Montrez comment le texte
mêle la déférence à l'égard des lettres anciennes à un
propos résolument moderne.
- Lisez la
et recensez les moyens par lesquels Du Bellay propose
d'enrichir la langue française. En consultant les pages
que nous consacrons au , vous pourrez vous exercer à des
recherches lexicales portant sur des mots que l'on
commence à fabriquer au XVIème siècle à partir de
radicaux grecs. Dans la page consacrée à la , vous pourrez
prendre connaissance de textes et de liens qui vous
aideront à replacer le débat dans le monde
d'aujourd'hui.
2. Le
métier poétique.
Les manifestes poétiques abondent chez les membres de la
Pléiade. Ce souci de codification répond à l'anarchie des
formes et des genres du Moyen Age, mais correspond aussi à
la volonté de définir une place nouvelle pour le
poète. Loin du courtisan, familier des fêtes et des
récréations princières, celui-ci est invité à un travail
dont la Pléiade a souligné l'aridité : « Qui
veut voler par les mains et bouches des hommes doit
longuement demeurer en sa chambre; et qui désire vivre en la
mémoire de la postérité doit, comme mort en soi-même, suer
et trembler maintes fois» (Du Bellay Défense,
II, III).
|
Jacques
Peletier du Mans (1517-1582)
Art poétique (1555)
(texte
modernisé)
|
|
Les vices se reconnaissent aisément pour être
l'opposé des vertus, et on ne peut souligner
justement celles-ci sans rappeler leur contraire.
Comme nous avons dit que la clarté est le plus
remarquable ornement du poème, ainsi l'obscurité
se comptera pour son premier vice. Car il n'y a
point de différence entre ne pas parler et ne pas
être compris. Je penserais même qu'il est plus
malhabile de parler obscurément que de ne pas
parler du tout, car on occupe le temps d'un homme
qui s'amuserait ailleurs.
Mais y a manière de juger les obscurités.
Car si le poète n'use pas de mots trop recherchés,
ni trop affectés, ni impropres, s'il n'est pas
trop bref, s'il a suivi une bonne organisation
(autant de points qui garantissent contre
l'obscurité), alors ce sera la faute du lecteur,
et non de l'auteur, s'il n'est pas compris. De
même, si pour quelque fable alléguée en passant,
si pour quelque problème de philosophie destiné à
enrichir le discours, si pour quelque récit conté
incidemment, en somme, si pour quelque allusion
judicieuse, le lecteur est lent à comprendre,
qu'il s'en accuse, et non pas l'auteur, qui serait
plutôt coupable s'il avait écrit trop longuement
et s'il enseignait comme dans une école.
Mais nous parlons ici de l'obscurité
naturelle et, pour ainsi dire, radicale, qui se
reconnaît au fait que l'écrivain, en tout point,
ne sort pas de lui-même et persiste dans son style
incompréhensible; quand on voit des points en lui
qui pourraient se traiter plus clairement, quand
on voit que cela lui vient d'une saisie trop
éloignée; quand, après avoir longuement pesé ses
intentions, on est contraint d'en deviner la
moitié.
Il faut qu'en tout point un écrit soit
louable du point de vue des doctes, mais qu'aux
moins savants il offre aussitôt une apparence de
beauté et l'espoir de pouvoir le comprendre. Et
cela réside dans le fait de ne dire ni plus ni
moins qu'il convient, chose très difficile,
surtout dans notre poésie française, où la rime
nous tient en grande sujétion. Mais c'est une
raison supplémentaire de s'efforcer à la vertu et
de montrer que la rime est d'une grande utilité,
parce qu'elle oblige à penser longuement à bien
faire. Sans cela, affluent toutes sortes de vices,
comme, entre autres, la contradiction, qui, pour
ne rien dissimuler, est fort fréquente dans notre
poésie française où il y en a peu qui ne se
contredisent pas, non seulement d'une œuvre à
l'autre, mais aussi dans une même œuvre, et au
même endroit. Ceci est un vice fort condamnable,
qu'on doit d'autant plus soigneusement éviter
qu'il arrive facilement. Car l'homme, étant
composé de contraires et ayant l'esprit exposé à
plein d'objets divers, douteux, obscurs, vrais et
faux, ne peut que malaisément se maintenir dans un
train invariable, sans trouver des rencontres, des
obstacles, des troubles qui lui font oublier sa
voie droite. De la même cause, viennent les
redites, un peu plus excusables mais qui qui
dénotent une nonchalance de style et d'examen.
|
 Questions
: Questions
:
- Récapitulez les vertus préconisées par l'auteur.
- En quoi les
recommandations de Peletier du Mans annoncent-elles
l'idéal classique ? Prenez notamment connaissance des
textes de Boileau et de La Bruyère dans la page
suivante, consacrée au .
3. Jeux
poétiques.
La Pléiade fut une école exclusivement littéraire. Si la
satire politique, voire un certain engagement, ne sont pas
absents de l'œuvre de Ronsard ou de Du Bellay, ce n'est
qu'au terme d'une maturation personnelle qui leur a fait
mesurer le caractère un peu artificiel et maniériste des
exercices et variations poétiques auxquels les membres de
la Brigade s'adonnent de préférence. L'influence de
Pétrarque est ici déterminante, qui offre un modèle
perpétuellement renouvelé de déclaration amoureuse :
recherches rares, expressions difficiles, traits d'esprit
brillants (les concetti) orientent
l'écriture vers une préciosité dont le siècle suivant se
souviendra. Avec le temps, tous ces jeux apparurent un peu
faux et engagèrent nos poètes vers un souci d'authenticité
: « J'ai oublié l'art de pétrarquiser / Je veux
d'amour franchement deviser, / Sans vous flatter et sans me
déguiser » (Du Bellay).
|
Le
topos de la « Belle Matineuse », dont l'éclat
fait pâlir l'Aurore, prend naissance avec un
sonnet de l'italien Rinieri.
Il
donna lieu à de multiples variations dans
toute l'Europe et les poètes de la Pléiade en
firent un de leurs motifs privilégiés. On
trouvera ci-dessous la version traduite de
Rinieri et trois adaptations différentes (orthographe
non modernisée) :
|
La mer était paisible; les forêts et les
prés découvraient au ciel leurs fastes,
fleurs et frondaisons, et déjà la nuit
déchirait son voile, et éperonnait ses
sombres chevaux ailés.
L'aurore faisait tomber de ses
cheveux dorés des perles d'un éclat vif et
glacé, et déjà le Dieu qui naquit à Délos
lançait ses rayons depuis les rives
parfumées et précieuses de l'Orient;
Quand d'Occident un soleil plus beau
se leva, illuminant la face du jour et
faisant pâlir l'image du Levant.
Étoiles lumineuses, si rapides,
éternelles et solitaires, dans la paix où
vous êtes le beau visage que j'adore parut
alors plus brillant et plus gracieux que
vous.
Antonio
Rinieri
|
Déjà
la nuit en son parc amassoit
Un grand troupeau d'étoiles vagabondes,
Et pour entrer aux cavernes profondes
Fuyant le jour, ses noirs chevaulx chassoit ;
Déjà le ciel aux Indes rougissoit,
Et l'Aulbe encor de ses tresses tant blondes
Faisant gresler mille perlettes rondes,
De ses thésorts les prez enrichissoit ;
Quand d'occident, comme une étoile vive,
Je vy sortir dessus ta verte rive,
O fleuve mien ! une Nymphe en rient . .
Alors voyant cette nouvelle Aurore,
Le jour honteux d'un double teint colore
Et l'Angevin et l'Indique orient.
orient.
J. du Bellay, L'Olive sonnet
LXXXIII (1549)
|
De
ses cheveulx la rousoyante Aurore
Aurore
Eparsement les Indes remplissoyt,
Et ja le ciel à longz traitz rougissoyt
De meint esmail qui le matin decore,
Quand elle veit
la Nymphe que j'adore
Tresser son chef, dont l'or, qui jaunissoit,
Le crespe honneur du sien esblouissoit,
Voire elle mesme et tout le ciel encore.
Lors ses cheveux
vergongneuse arracha,
Si qu'en pleurant sa face elle cacha,
Tant la beaulté des beaultez luy ennuye :
Et ses souspirs
parmy l'air se suyvantz,
Troys jours entiers enfanterent des ventz,
Sa honte un feu, et ses yeulx une pluye.
P. de Ronsard, Amours sonnet
XCI
(1552-1553)
|
Quand
je te vis entre un millier de Dames,
L'elite et fleur des nobles, et plus belles,
Ta resplendeur telle estoyt parmy elles,
Quelle est Venus sur les celestes flames.
Amour adonq' se
vangea de mille ames
Qui luy avoyent jadis esté rebelles,
Telles tes yeux eurent leurs estincelles
Par qui les cueurs d'un chacun tu enflames.
Phebus, jaloux
de ta lumiere sainte,
Couvrit le ciel d'un tenebreux nuage,
Mais l'air, maugré sa clarté toute estainte,
Fut plus serain
autour de ton visage.
Adonq' le dieu d'une rage contreinte
Versa de pleurs un large marescage.
J.A. de Baïf, Les Amours de Méline (1552)
|
 Questions
: Questions
:
- Déterminez les points communs de ces trois textes puis
leurs caractères spécifiques. Lequel vous semble le plus
réussi ?
-
Au siècle suivant, le motif de la «
belle Matineuse » déclencha une querelle littéraire
célèbre : les salons précieux se partagèrent en effet
autour des mérites respectifs d'un sonnet de et d'un autre de . Vous pourrez les consulter tous
les deux et constater l'évolution du motif vers un
certain maniérisme.
4.
L'inspiration.
A l'école de Platon, les poètes de la Pléiade ont eu un
haute idée de leur mission et les pages ne manquent pas,
notamment chez Ronsard, où l'on note une fière confiance
dans leur génie. Inspiré par un souffle divin, le poète
est déjà le «suprême savant» dont parlera Rimbaud, et
aussi celui qui parvient à la Connaissance au prix d'une
ascèse solitaire. Au-delà du Romantisme, qui voudra
inscrire le poète dans la Cité, c'est au Parnasse et au
Symbolisme que font songer ces vers de Ronsard adressés au
poète : «Tu n'auras point de peur qu'un
Roi, de sa tempête,/ Te vienne en moins d'un jour
escarbouiller la tête / Ou confisquer tes biens, mais, tout
paisible et coi, / Tu vivras dans les bois pour la Muse et
pour toi. »
Pierre de
Ronsard (1524-1585)
Hymne de l'Automne (1555)
[Vous
pourrez prendre connaissance de la sur la page que nous
consacrons à l' .]
(orthographe
non modernisée)
|
 |
Le
jour que je fu né, Apollon qui preside
Aux Muses, me servit en ce monde de guide,
M'anima d'un esprit subtil et vigoureux,
Et me fit de science et d'honneur amoureux.
En lieu des grands tresors et des richesses
vaines,
Qui aveuglent les yeux des personnes humaines,
Me donna pour partage une fureur d'esprit,
Et l'art de bien coucher ma verve par escrit.
Il me haussa le cœur, haussa la fantasie , ,
M'inspirant dedans l'âme un don de poësie,
Que Dieu n'a concedé qu'à l'esprit agité
Des poignans aiguillons de sa Divinité.
Quand l'homme en est touché, il devient un
prophete,
Il predit toute chose avant qu'elle soit faite,
Il cognoist la nature et les secrets des cieux,
Et d'un esprit bouillant s'eleve entre les
Dieux.
Il cognoist la vertu des herbes et des pierres,
Il enferme les vents, il charme les
tonnerres ;
Sciences que le peuple admire, et ne sçait pas
Que Dieu les va donnant aux hommes d'icy bas,
Quand ils ont de l'humain les âmes separées,
Et qu'à telle fureur elles sont preparées
Par oraison, par jeusne et penitence aussi,
Dont aujourd'huy le monde a bien peu de souci.
Car Dieu ne communique aux hommes ses mysteres,
S'ils ne sont vertueux, devots et solitaires,
Eslongnez des tyrans, et des peuples qui ont
La malice en la main et l'impudence au front,
Brulez d'ambition et tourmentez d'envie,
Qui leur sert de bourreau tout le temps de leur
vie. |
Je
n'avois pas quinze ans que les monts et les bois
Et les eaux me plaisoient plus que la cour des
Rois,
Et les noires forests espaisses de ramées,
Et du bec des oiseaux les roches entamées ;
Une valée, un antre en horreur obscurci,
Un desert effroyable estoit tout mon
souci ;
A fin de voir au soir les Nymphes et les Fées
Danser dessous la lune en cotte par les prées
(Fantastique d'esprit), et de voir les Sylvains
Estre boucs par les pieds et hommes par les
mains,
Et porter sur le front des cornes en la sorte
Qu'un petit aignelet de quatre mois les porte.
J'allois aprés la dance, et craintif je pressois
Mes pas dedans le trac des Nymphes, et pensois
Que pour mettre mon pied en leur trace poudreuse
J'aurois incontinent l'âme plus genereuse ;
Ainsi que l'Ascrean qui gravement sonna
qui gravement sonna
Quand l'une des neuf Sœurs du laurier luy donna.
Or je ne fu trompé de ma jeune entreprise ;
Car la gentille Euterpe ayant ma dextre prise,
ayant ma dextre prise,
Pour m'oster le mortel par neuf fois me lava
De l'eau d'une fontaine où peu de monde va,
Me charma par neuf fois, puis d'une bouche
enflée
(Ayant dessus mon chef son haleine souflée)
Me herissa le poil de crainte et de fureur,
Et me remplit le cœur d'ingenieuse erreur,
En me disant ainsi : « Puisque tu veux
nous suivre,
Heureux après la mort nous te ferons revivre
Par longue renommée, et ton los ennobli
ennobli
Accablé du tombeau n'ira point en oubli.» |
 Questions
: Questions
:
L'autre Philosophie habite sous la nue,
A qui tant seulement cette terre est connue
Sans se loger au ciel ; le cœur qui lui défaut
Ne lui laisse entreprendre un voyage si haut.
Elle a pour son sujet les négoces civiles,
L'équité, la justice et le repos des villes ;
Et au chant de sa lyre, a fait sortir des bois
Les hommes forestiers pour leur bailler des
lois.
Elle sait la vertu des herbes et des plantes,
Elle va dessous terre aux crevasses béantes
Tirer l'argent et l'or et chercher de sa main
Le fer qui doit rougir en notre sang humain.
Puis afin que le peuple ignorant ne méprise
La vérité connue après l'avoir apprise
D'un voile bien subtil (comme les peintres font
Aux tableaux animés) lui couvre tout le front
Et laisse seulement tout au travers du voile
Paraître ses rayons comme une belle étoile,
Afin que le vulgaire ait désir de chercher
La couverte beauté dont il n'ose approcher.
Hymne
de l'Hiver, 1564.
|
- Si les
poètes de la Pléiade se placent si souvent sous le
patronage de l'Antiquité, c'est que la leur offre comme un lexique que le
lecteur lettré déchiffrera sans mal. Comparaisons,
métaphores appartiennent à ce fonds archétypal qui ne
compromet nullement la qualité naturelle de
l'inspiration. On en jugera par l'ode suivante où la
référence antique ne manque pas de surgir après une
élégie personnelle où le poète confie sa hantise de la
décrépitude physique (Ronsard, Odes, 4, 11,
orthographe modernisée) :
|
5
10
15
20
|
Ma douce jouvence est passée,
Ma première force est cassée,
J'ai la dent noire et le chef blanc;
Mes nerfs sont dissous, et mes veines,
Tant j'ai le corps froid, ne sont pleines
Que d'une eau rousse en lieu de sang.
Adieu, ma lyre; adieu, fillettes,
Jadis mes douces amourettes.
Adieu, je sens venir ma fin;
Nul passe-temps de ma jeunesse
Ne m'accompagne en la vieillesse,
Que le feu, le lit et le vin.
J'ai la tête tout étourdie
De trop d'ans et de maladie;
De tous côtés le soin me mord,
Et, soit que j'aille ou que je tarde,
Toujours après moi je regarde
Si je verrai venir la mort,
Qui doit, ce me semble, à toute heure
Me mener là bas, où demeure
Je ne sais quel Pluton, qui tient
Ouvert à tous venants un antre,
Où bien facilement on entre,
Mais d'où jamais on ne revient.
|
 
|